
Bernard ALAVOINE, Noëlle BENHAMOU, Marie-Françoise LEMONNIER-DELPY
Écrire à quatre mains (XIX-XXIe siècles)
Presses Universitaires d'Artois (Octobre 2025)
Écrire à quatre mains (XIXe-XXIe siècles) aborde la passionnante question de la création en collaboration d’une œuvre, littéraire ou artistique, en France et dans divers pays (Allemagne, Italie, Iran, Canada), du XIXe siècle à aujourd’hui. Accompagné de quelques articles généraux sur ce phénomène, cet ouvrage examine des cas, singuliers ou représentatifs d’une pratique interactive de l’art, devenue très actuelle.
Il réunit 21 études sur des œuvres impliquant deux ou plusieurs auteurs et/ou autrices engagés ensemble dans une création selon des modalités complexes, cachées ou non, qui interroge la notion d’auctorialité.
Ce volume scrute la nature de la co-création : comment et où apparaît-elle ? À quels desseins répond-elle ? Que savons-nous des relations de pouvoir, de complicité ou de défiance qui l’accompagnent ? La co-création n’a cessé d’inventer ses propres stratégies et règles de fonctionnement et de publication. Elle s’est récemment emparée des nouvelles technologies ou des situations de confinement pour forger de nouveaux objets.
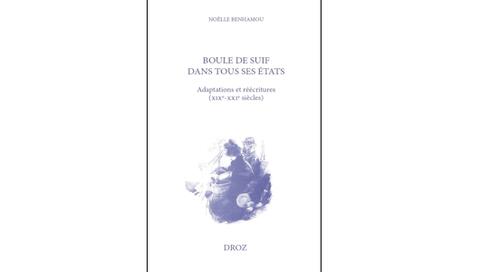
Noëlle BENHAMOU
Boule de suif dans tous ses états : Adaptations et réécritures (XIXe-XXIe siècles)
Droz (Juillet 2025)
« Boule de suif » (1880), nouvelle des Soirées de Médan, a fait connaître Maupassant au public parisien. On sait moins que l’histoire de son héroïne normande a donné lieu à de multiples adaptations et réécritures de 1884 à nos jours, dans les arts (peinture, dessin, théâtre, cinéma, télévision, opéra, comédie musicale, bande dessinée) et dans de multiples pays (Allemagne, Angleterre, Autriche, Espagne, États-Unis, France, Italie, URSS).
Noëlle Benhamou fait ici le point sur les différentes approches et les messages transmis par les adaptateurs qui se sont appropriés le texte de Maupassant pour en fournir leur propre lecture à travers des arts ayant chacun une esthétique particulière. Dans cet essai sont analysées les réécritures du personnage maupassantien de la prostituée patriote, qui devient une figure de la Résistance à travers le monde, acquérant ainsi un statut de mythe littéraire.
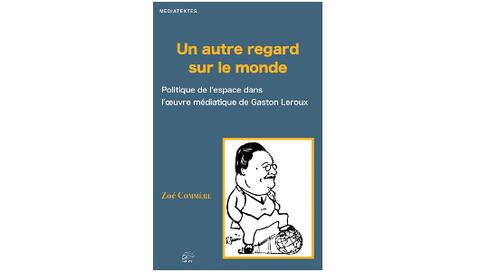
Zoé COMMÈRE
Un autre regard sur le monde, Politique de l’espace dans l’œuvre médiatique de Gaston Leroux
Presses Universitaires de Limoges (Mars 2025)
Gaston Leroux (1868-1927), d’abord grand reporter pour Le Matin, a fait du journalisme un véritable laboratoire d’écriture avant d’y publier ses romans feuilletons. Son œuvre, profondément ancrée dans l’univers médiatique, articule fiction et actualité en explorant une problématique spatiale essentielle.
Loin d’être un simple décor, l’espace y joue un rôle structurant, conjuguant influences intertextuelles et enjeux géopolitiques. Ses reportages comme ses récits transposent les dynamiques diplomatiques de la France, mêlant patriotisme et réinterprétation critique des modèles dominants. Si Leroux mobilise parfois des stéréotypes, il exploite la fiction pour ouvrir des brèches dans le discours doxique de son époque, questionnant les effets de la mondialisation naissante.
À travers des espaces imaginaires ou réinventés, il propose ainsi une réflexion originale sur l’organisation politique et territoriale du monde. Par son approche novatrice, cet ouvrage qui lui est consacré s’impose aujourd’hui comme une contribution essentielle, éclairant sous un jour nouveau l’articulation entre fiction, médias et représentations géopolitiques.
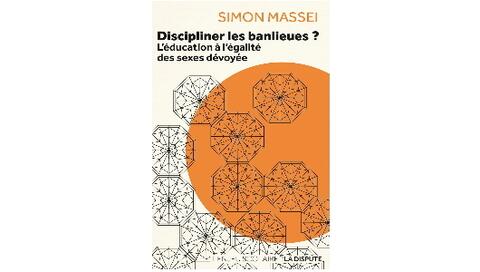
Simon MASSEI
Discipliner les banlieues ? L'éducation à l'égalité des sexes dévoyée
L'enjeu scolaire / La dispute (Octobre 2024)
Cours de masturbation à l’école maternelle, attouchements sexuels sur les élèves au nom de l’enseignement de la « théorie du genre », implication de la franc-maçonnerie ou de réseaux pédophiles… Ces dernières années, l’éducation à l’égalité entre les sexes à l’école n’a cessé d’alimenter rumeurs absurdes et polémiques réactionnaires. Mais l’essentiel est ailleurs.
Dans cette enquête menée des ministères aux salles de classe, Simon Massei montre que les politiques d’éducation à l’égalité entre les sexes ciblent principalement le public racisé des établissements de banlieues pauvres. En reconstituant l’histoire de cette politique scolaire, depuis sa production dans le champ administratif à sa réception par les élèves et leur famille, en passant par sa prise en charge par le tissu associatif et local, l’auteur donne à voir comment se nouent les rapports de domination à l’école. Comprendre le phénomène de racialisation du sexisme, comme la construction du « problème musulman », exige dès lors de ne pas les réduire à de simples discours journalistiques ou à des représentations sociales : ce sont des constructions politiques, auxquelles l’institution scolaire, c’est-à-dire l’État, prend directement part.

